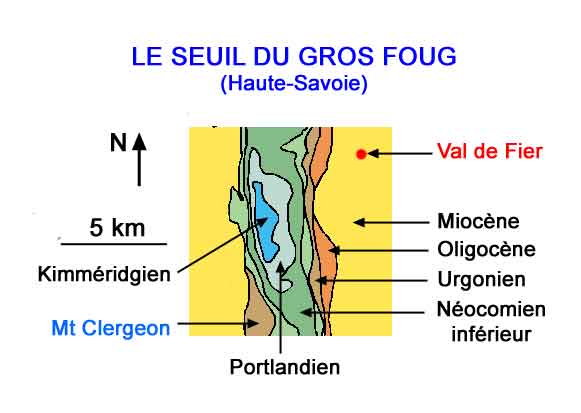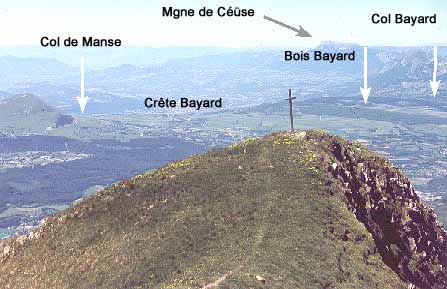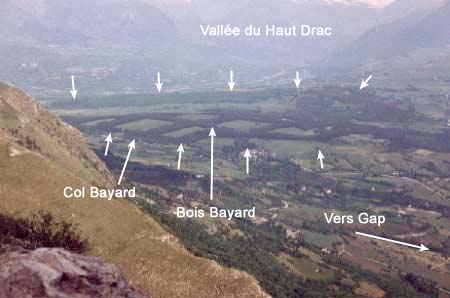LES EPAULES GLACIAIRES
Dans certains cas, les épaulements d'une vallée glaciaire - que nous appellerons alors épaules - sont très sensiblement horizontaux et atteignent de très grandes dimensions.
Quelque exemples :
- l'épaule de Montfroid ( Eau d'Olle, Savoie )
- la crête de Tournoux au-dessus de la Condamine-Châtelard ( Ubaye, Hautes-Alpes ), horizontale à ± 20 m près sur une longueur de 1,5 km
- la crête de Tournoux au-dessus de la Condamine-Châtelard ( Ubaye, Hautes-Alpes ), horizontale à ± 20 m près sur une longueur de 1,5 km
- la Côte Névachaise ( vallée de la Clarée, Hautes-Alpes ), horizontale à ± 10 m près sur 1 km
- la crête des Guillets ( Saint Nizier du Moucherotte, Isère ), horizontale à ± 10 m près sur 2,5 km.
Dans ce dernier cas, toutefois, une origine structurale peut également être évoquée, car il s'agit du dos de la voûte sénonienne enveloppant le célèbre pli de Sassenage.
C'est une application de ce que nous disions en introduction, que l'on pourra relire ici
Mais c'est la vallée de l'Isère, dans les environs de Moûtiers (Savoie), qui nous paraît présenter les deux sites les plus intéressants car ils nous permettent attribuer de manière certaine la formation des épaules à l'oeuvre des glaciers.
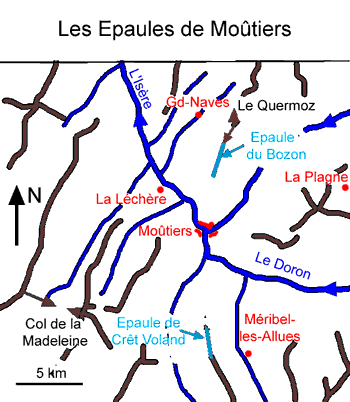
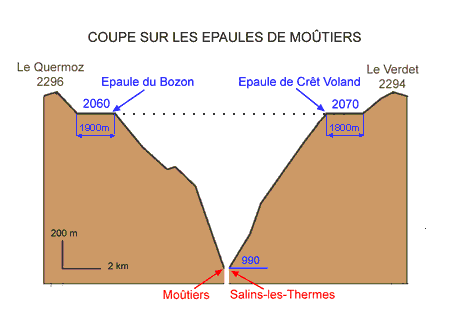
- rive gauche de l'Isère, l'arête du Dos de Crêt Voland au Roc de Fer, au dessus de St-Martin-de-Belleville (Savoie) est horizontale à 2070 m ± 22 m sur une longueur de 1800 m. La présence de deux lacs sur l'arête même montre déjà bien son origine glaciaire, confirmée par l'existence de sillons vallonnés sur le versant est, légèrement en contrebas (2030 m).
- exactement en face de ce site, sur la rive opposée de l'Isère et symétriquement par rapport à Moûtiers, l'épaule du Bozon, portée par l'arête sud-sud-ouest du Quermoz, n'est pas moins remarquable : sur une longueur de 1900 m, l'altitude n'y varie que de ± 20 m, autour de 2060 m. Elle aussi abrite un lac.
L'égalité d'altitude de ces deux épaules, en dépit d'une lithologie différente (schistes et grès houillers à Crêt Voland et, au Bozon, brèches jurassiques du Quermoz et microbrèches crétacées) montre bien qu'elles ont été rabotées par le même outil.
Leur situation en crête ne permet pas d'imputer leur formation à une érosion autre que glaciaire (fluviale ou torrentielle par exemple) ; il nous paraît donc certain qu'il s'agit là de l'oeuvre des glaciers qui les ont franchies pendant de nombreuses glaciations.
De plus, l'altitude de 2060 et 2070 m des deux sites est très proche de celle que l'on peut déduire de l'examen de notre graphique relatif à l'Isère au-dessus de Moûtiers.
Nous conviendrons toutefois ne pas comprendre, pour l'instant, comment l'action de la glace a pu engendrer des formes d'une pareille régularité.
La même remarque va s'appliquer aux seuils.
C'est une application de ce que nous disions en introduction, que l'on pourra relire ici
Mais c'est la vallée de l'Isère, dans les environs de Moûtiers (Savoie), qui nous paraît présenter les deux sites les plus intéressants car ils nous permettent attribuer de manière certaine la formation des épaules à l'oeuvre des glaciers.
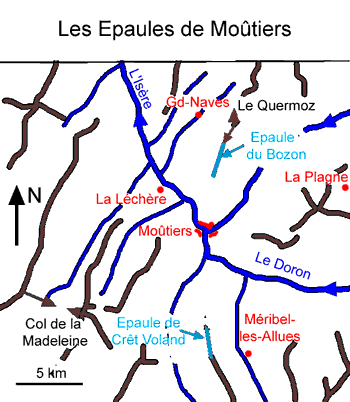
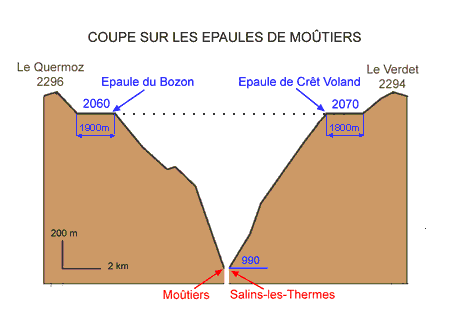
- rive gauche de l'Isère, l'arête du Dos de Crêt Voland au Roc de Fer, au dessus de St-Martin-de-Belleville (Savoie) est horizontale à 2070 m ± 22 m sur une longueur de 1800 m. La présence de deux lacs sur l'arête même montre déjà bien son origine glaciaire, confirmée par l'existence de sillons vallonnés sur le versant est, légèrement en contrebas (2030 m).
- exactement en face de ce site, sur la rive opposée de l'Isère et symétriquement par rapport à Moûtiers, l'épaule du Bozon, portée par l'arête sud-sud-ouest du Quermoz, n'est pas moins remarquable : sur une longueur de 1900 m, l'altitude n'y varie que de ± 20 m, autour de 2060 m. Elle aussi abrite un lac.
L'égalité d'altitude de ces deux épaules, en dépit d'une lithologie différente (schistes et grès houillers à Crêt Voland et, au Bozon, brèches jurassiques du Quermoz et microbrèches crétacées) montre bien qu'elles ont été rabotées par le même outil.
Leur situation en crête ne permet pas d'imputer leur formation à une érosion autre que glaciaire (fluviale ou torrentielle par exemple) ; il nous paraît donc certain qu'il s'agit là de l'oeuvre des glaciers qui les ont franchies pendant de nombreuses glaciations.
De plus, l'altitude de 2060 et 2070 m des deux sites est très proche de celle que l'on peut déduire de l'examen de notre graphique relatif à l'Isère au-dessus de Moûtiers.
Nous conviendrons toutefois ne pas comprendre, pour l'instant, comment l'action de la glace a pu engendrer des formes d'une pareille régularité.
La même remarque va s'appliquer aux seuils.